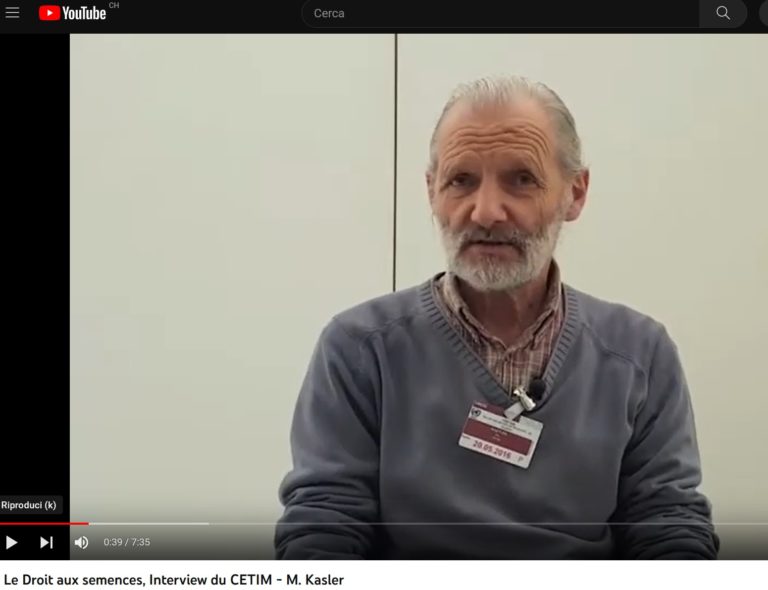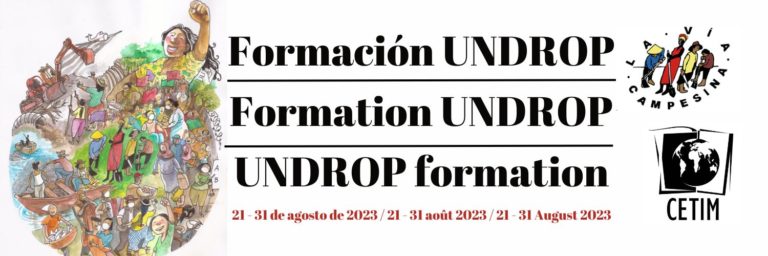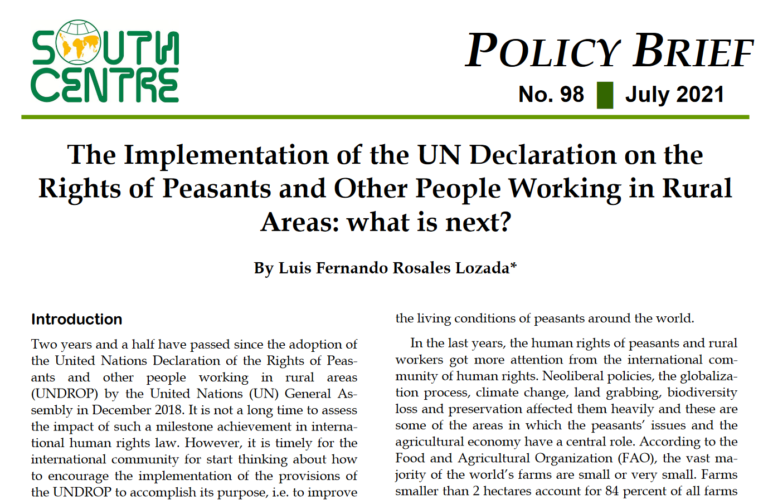Cultiver là où le monde regarde ailleurs
Article écrit par Fuad Abu Saif, activiste palestinien et chercheur sur les luttes pour la terre et la dignité. Il affilié au syndicat Union of Agricultural Work Committees et membre de la coordination internationale de La Via Campesina. Cet article a été écrit pour Défendre les droits des paysan.nes, dans le cadre de la journée internationale des luttes paysannes, le 17 avril. Pour, qu’en cette journée, nos yeux se tournent vers les paysan.nes palestinien.nes, vers leurs souffrances, vers les violences qu’ils et elles subissent, mais aussi vers leur continuelle et toujours renouvelée résistance pour rester enraciné.es sur leurs terres.
Introduction
Dans les champs de la vallée du Jourdain et le long des pentes rocheuses du sud d’Hébron, les agriculteurs palestiniens se battent pour exister. Ici, l’agriculture est un acte quotidien de survie dans un système colonial bien ancré qui déploie la loi, la violence et l’étranglement économique pour arracher les gens de leur terre.
Depuis octobre 2023, la Cisjordanie est entrée dans une nouvelle phase d’intensification de la dépossession. Rien n’est arbitraire. Les ordres de démolition sont exécutés avec une précision bureaucratique. Les ressources vitales, telles que l’eau, les pâturages et la mobilité, sont coupées sous le couvert de la « souveraineté ». Dans une déclaration éloquente et sans complaisance, le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, s’est vanté il y a quelques jours que 2024 a été une année record en matière de démolitions de maisons et d’infrastructures palestiniennes, célébrant cela comme une réussite de l’imposition du contrôle israélien sur la zone C. Dans un environnement aussi ouvertement hostile, la notion de développement devient absurde, et même un minimum de stabilité semble hors de portée.

Cette violence n’est pas fortuite, elle est structurelle. Les agriculteurs palestiniens ne sont pas considérés comme des individus, mais comme des obstacles géographiques à éliminer. Dans des endroits comme Wadi al-Seeq et Khan al-Ahmar, les communautés bédouines et rurales subissent des attaques méthodiques : cultures brûlées, puits empoisonnés, bétail volé et déplacements bloqués. Ces attaques font partie d’une stratégie délibérée visant à créer des conditions invivables et à forcer les gens à partir sans qu’aucune expulsion officielle n’ait eu lieu.
Sur le plan économique, l’agriculture est étouffée. L’occupation israélienne contrôle 85 % des ressources en eau de la Cisjordanie, alors que les Palestiniens n’ont pas le droit de forer ou d’entretenir des puits. Selon les données de la Banque mondiale, la productivité agricole palestinienne a diminué d’au moins 35 % au cours des six derniers mois. En revanche, les colonies agricoles israéliennes voisines prospèrent grâce à un accès illimité à l’eau, aux infrastructures et aux marchés internationaux, ce qui met en évidence l’inégalité criante ancrée dans la terre.
Considérer l’agriculteur palestinien uniquement comme un symbole de résilience ou de nostalgie, c’est passer à côté de l’essentiel. Aujourd’hui, l’agriculteur est le défenseur en première ligne de la souveraineté, de la justice environnementale et du droit à la vie elle-même. La lutte ne porte pas sur une seule récolte, mais sur la sauvegarde de la possibilité même d’une présence palestinienne continue sur la terre, au-delà des ghettos urbains et des enclaves fragmentées.
Cet article vise à exposer le système brutal de violence qui se cache derrière ces violations et à amplifier les voix des agriculteurs – femmes et hommes – qui continuent à cultiver leurs terres par défi, en se souvenant, et avec la ferme conviction que la terre perdurera au-delà du régime qui cherche à les effacer.
Effacer les communautés par le vol des terres et les expulsions
La politique de confiscation des terres et de déplacement forcé menée depuis des décennies par l’occupant israélien en Cisjordanie s’est considérablement intensifiée depuis le 7 octobre 2023, se transformant en une opération de grande envergure visant à redessiner la réalité démographique de la région. La stratégie qui sous-tend ce processus ne se limite plus à des actes isolés de dépossession, elle s’est transformée en une campagne systématique d’effacement territorial et d’ingénierie démographique, visant les fondements mêmes de la vie agricole palestinienne.
Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), Israël a
saisi plus de 50 000 dunams de terres agricoles palestiniennes dans les mois qui ont suivi octobre 2023, ce qui constitue la plus grande vague de confiscation depuis plus de deux décennies. Ces saisies de terres sont concentrées dans des régions agricoles critiques, notamment le nord de la vallée du Jourdain, le sud des collines d’Hébron et les zones rurales entourant Naplouse et Salfit. Ces zones n’ont pas été choisies arbitrairement ; elles représentent le cœur de l’agriculture de la
Palestine et les derniers espaces où les pratiques agricoles traditionnelles persistent malgré l’expansion des colons et le contrôle militaire.

Oliviers déracinés et vandalisés dans des terres agricoles palestiniennes, ciblées par des colons près de Salfit.
Parallèlement, le nombre de déplacements forcés a augmenté. Plus de 180 familles d’agriculteurs ont été expulsées de leurs maisons, principalement dans la zone C, où Israël conserve toute l’autorité civile et militaire. Ces expulsions sont souvent précédées d’un double assaut : premièrement, l’émission d’ordres de démolition ou d’expulsion dans des cadres juridiques opaques ; deuxièmement, d’expulsion dans des cadres juridiques opaques, puis un déferlement de violence de la part des colons, allant de l’incendie des cultures et du vol de bétail à des attaques à balles réelles et à la destruction de maisons. Ces actes sont généralement perpétrés en toute impunité et sous la surveillance ou la protection des forces militaires israéliennes.
Des villages comme Al-Zubeidat et Ein al-Hilweh dans la vallée du Jourdain, et Masafer Yatta dans le sud des collines d’Hébron, ont été les plus durement touchés par ces agressions. Dans ces communautés rurales et dans d’autres, les milices de colons soutenues par la police des frontières et munies d’armes de type militaire envahissent régulièrement les terres agricoles, intimident les habitants et détruisent les biens. L’objectif est clair : rendre ces zones inhabitables pour les Palestiniens, les forcer à partir et ouvrir la voie à la poursuite de l’expansion des colons. Amnesty International et B’Tselem ont recensé des dizaines d’attaques coordonnées de ce type entre octobre 2023 et mars 2024.
L’expansion des colonies est la colonne vertébrale de cette stratégie. Depuis octobre, le gouvernement israélien a élaboré des plans pour plus de 13 000 nouvelles unités de peuplement en Cisjordanie, soit une augmentation de 40 % par rapport aux années précédentes. Ces projets s’accompagnent de la construction de nouvelles routes de contournement réservées aux colons et de points de contrôle militaires, qui divisent les terres palestiniennes en enclaves déconnectées les unes des autres. Dans de nombreuses régions, les Palestiniens doivent désormais passer par des barrières électroniques ou obtenir des permis militaires pour accéder à leurs propres terres agricoles. Il en résulte un étranglement lent mais délibéré de la vie rurale palestinienne, où les déplacements, les cultures et la cohésion de la communauté sont progressivement sapés.
Cette campagne de dépossession coïncide avec l’un des épisodes les plus meurtriers de l’histoire moderne de la Palestine, le génocide en cours à Gaza, où plus de 160 000 personnes ont été tuées ou blessées. Alors que l’attention du monde entier est focalisée sur la guerre à Gaza, l’occupation israélienne accélère discrètement son projet de transformation démographique en Cisjordanie. Selon un rapport Blinx de 2025, l’année en cours a déjà établi un record de démolitions de maisons en Cisjordanie – un reflet stupéfiant de la tentative d’Israël d’effacer des communautés palestiniennes entières sous le radar du système international.
En résumé, la confiscation des terres et les déplacements forcés en Cisjordanie sont des outils d’ingénierie ethnique. Ces politiques sont conçues pour établir des « faits sur le terrain » irréversibles, fragmenter la géographie palestinienne et détruire la possibilité d’un État palestinien viable et d’un seul tenant. Au fond ,elles représentent une attaque contre l’existence elle-même, faisant de chaque agriculteur palestinien un défenseur en première ligne de son identité, de sa dignité et de sa survie.
Intensification des attaques des colons
Ces derniers mois, la violence des colons s’est dangereusement transformée en Cisjordanie. Ne se limitant plus à des attaques isolées, elle s’est muée en une campagne organisée et soutenue de nettoyage ethnique, ciblant délibérément les agriculteurs palestiniens et leurs communautés. Les groupes de colons armés, qui agissent de manière de plus en plus coordonnée et impunie, souvent sous la surveillance ou la protection des forces militaires israéliennes, sont désormais au cœur d’une stratégie plus large visant à débarrasser la Palestine rurale de sa population autochtone et à renforcer le contrôle colonial sur les terres. Selon Amnesty International (2024), plus de 410 attaques documentées ont été menées contre des agriculteurs palestiniens au cours des quatre mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre génocidaire à Gaza, ce qui représente une augmentation de 75 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ces attaques sont méthodiques, coordonnées et exécutées avec un objectif clair : rompre la relation entre les Palestiniens et leur terre.
Les tactiques utilisées sont à la fois violentes et symboliques. Dans les régions de Ramallah et de Naplouse, en particulier dans des villages comme Turmus Ayya, Al-Mughayyir et Madama, les colons ont détruit plus de 6 200 oliviers, souvent centenaires. L’olivier, symbole de l’enracinement et de la survie économique des Palestiniens, est désormais déraciné de l’identité culturelle et économique de la population. Au-delà du sabotage agricole, les attaques ont pris un caractère plus militaire. Human Rights Watch (2024) a fait état de 45 incendies criminels de maisons, d’entrepôts et de silos à grains dans des villages proches des colonies, perpétrés après des raids coordonnés de colons sous la protection de l’armée israélienne. Les pompiers palestiniens ont souvent été empêchés d’accéder à ces zones, ce qui a permis aux incendies de détruire des infrastructures essentielles et des ressources pour le bétail.
L’évolution la plus alarmante est peut-être l’augmentation des agressions physiques directes. B’Tselem (2024) a recensé 380 incidents violents, y compris des passages à tabac, des tirs à balles réelles et l’expulsion forcée de familles qui travaillaient sur leurs terres. Au moins dix agriculteurs ont été tués et des dizaines d’autres ont été gravement blessés, nombre d’entre eux se retrouvant handicapés à vie et incapables de reprendre leurs activités agricoles.
Ces incidents s’inscrivent dans le cadre d’une politique systémique plus large. En l’espace de quelques mois, les colons ont saisi 270 parcelles agricoles palestiniennes, et ces appropriations sont rarement, voire jamais, contestées par les autorités israéliennes. Au contraire, plus de 85 % des plaintes déposées par des Palestiniens à la suite d’attaques de colons ont été rejetées sans enquête, ce qui démontre la complicité des autorités dans le processus de nettoyage ethnique. L’une des caractéristiques les plus alarmantes de la violence actuelle des colons est la coordination directe et visible entre les colons armés et les « gardes-frontières » israéliens. Dans des zones telles que Masafer Yatta, Qusra et Al-Zubeidat, les colons arrivent souvent en convois organisés, nombre d’entre eux portant visiblement des armes automatiques, tandis que l’armée israélienne reste à l’écart ou apporte son aide active en limitant les déplacements des Palestiniens, en émettant des ordres d’évacuation arbitraires ou en fermant les routes d’accès. Ce paysage militarisé a poussé des communautés agricoles entières au bord du gouffre. Depuis octobre 2023, plus de 180 familles palestiniennes ont été déplacées de force par une combinaison d’attaques de colons et d’un isolement renforcé par l’armée. La violence actuelle étouffe le système agricole palestinien, sapant sa viabilité en générant la peur, en sabotant les infrastructures essentielles et en refusant aux agriculteurs l’accès à leurs terres et à l’eau. Il s’agit d’une stratégie délibérée d’effacement progressif et systémique.

[Wagdi Eshtayah/Anadolu Agency].
Cette forme de violence coloniale doit être considérée pour ce qu’elle est : une campagne soutenue par l’État visant à démanteler l’économie rurale palestinienne, à briser la cohésion communautaire et à transformer de force les producteurs agricoles indépendants en une main-d’œuvre dépendante des marchés et des salaires israéliens.
La communauté internationale, préoccupée par le génocide catastrophique qui se déroule à Gaza, ne doit pas négliger ce processus parallèle en Cisjordanie, un processus qui utilise les outils de l’expansion coloniale, de l’application de l’apartheid et de la terreur des colons pour déraciner les Palestiniens de leurs terres, les priver de leur droit à l’alimentation et détruire les fondements de leur existence rurale.
Instrumentalisation de la politique de l’eau et fragmentation de l’agriculture
En Cisjordanie, la pénurie d’eau est le résultat direct de la politique israélienne visant à contrôler les ressources vitales et à affaiblir la résistance de l’agriculture palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, les autorités israéliennes ont intensifié les restrictions d’accès à l’eau, renforçant ainsi un système de contrôle hydropolitique vieux de plusieurs décennies, conçu pour éroder l’autosuffisance palestinienne et consolider l’expansion coloniale.
Selon Amnesty International (2024), l’occupation israélienne exerce un contrôle sur plus de 85 % des ressources en eau de la Cisjordanie, tout en refusant systématiquement aux Palestiniens l’autorisation de forer des puits ou de réparer les systèmes existants. Depuis l’escalade de la guerre, plus de 240 puits agricoles ont été détruits ou scellés par les forces israéliennes, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente (OCHA, 2024). Ces puits, particulièrement concentrés dans la vallée du Jourdain et les collines du sud de l’Hébron, étaient essentiels à l’irrigation des terres agricoles. Leur disparition a contribué à une baisse de 32% des terres agricoles irriguées et au quasi-effondrement de la production de légumes et d’agrumes dans de grandes parties de la Cisjordanie (FAO, 2024).
La pénurie d’eau est encore aggravée par la flambée des coûts : le prix de l’eau transportée a augmenté de 65 % depuis la fin de 2023, rendant l’irrigation inabordable pour la plupart des petits exploitants agricoles. Dans des régions comme Salfit, Tubas et Qalqilya, de nombreuses familles sont passées à des céréales tolérantes à la sécheresse ou ont complètement abandonné l’agriculture, ce qui a entraîné une perte généralisée de revenus et d’emplois.
Les forces israéliennes ont également pris pour cible les infrastructures hydrauliques de base. B’Tselem (2024) rapporte de nombreux cas où des unités militaires ont confisqué des réservoirs d’eau utilisés pour l’irrigation, en particulier dans les communautés agricoles isolées dépourvues de réseaux de canalisations. Parallèlement, plus de 75 sources naturelles, autrefois vitales pour les éleveurs palestiniens, ont été saisies ou transformées en parcs et sites de loisirs réservés aux colons, ce qui limite encore davantage l’accès des communautés aux sources d’eau essentielles.

Les conséquences économiques sont graves. La Banque mondiale (2024) note que l’inflation des denrées alimentaires en Cisjordanie a dépassé 41 %, conséquence directe de la perturbation de la production et de la diminution de l’offre locale. Cette crise affecte de manière disproportionnée les ménages ruraux et à faible revenu, qui sont désormais confrontés à un double fardeau : la baisse des revenus agricoles et les prix inabordables des denrées alimentaires de base. Parallèlement, l’effondrement des systèmes alimentaires locaux a renforcé la dépendance des Palestiniens à l’égard des marchés israéliens et de l’aide internationale.
À Gaza, la situation est encore plus catastrophique. Le blocus et la guerre en cours ont paralysé toute l’infrastructure de l’eau. Plus de 70 % des serres et des systèmes d’irrigation ont été détruits, et 98,1 % des ménages privés d’accès à l’eau déclarent avoir cessé toute activité agricole (FSALWG, 2025). L’accès à l’eau potable est devenu quasiment impossible, les risques de contamination augmentant et les produits essentiels à la purification de l’eau étant interdits d’accès.
L’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) consacre le droit à une nourriture suffisante et à être à l’abri de la faim, tandis que l’Observation générale n° 15 reconnaît explicitement que l’accès à l’eau est fondamental pour la dignité et la santé humaines. Le refus systématique de l’accès à l’eau pour les Palestiniens, y compris la destruction des puits et les régimes de permis discriminatoires, constitue une violation flagrante de ces obligations.
Cette dynamique n’est pas une coïncidence, elle représente une stratégie délibérée de déstabilisation de l’agriculture. En coupant l’eau, en limitant la réparation des infrastructures et en favorisant l’accès des colons, Israël met en œuvre un système structurel d’apartheid de l’eau qui viole le droit international. Dans le contexte palestinien, l’eau est une arme politique. La politique de l’eau de l’occupation est devenue un mécanisme central pour déraciner la vie rurale palestinienne, démanteler les fondements de la souveraineté alimentaire et approfondir la dépendance économique et territoriale. La lutte pour l’eau est donc indissociable de la lutte plus large pour la terre, la dignité et l’autodétermination.
La souveraineté alimentaire, une pratique de défi contre l’effacement structurel
Aujourd’hui, les agriculteurs palestiniens cultivent dans des conditions qui dépassent de loin les limites de la souffrance. Leurs champs sont encerclés par des colonies, surveillés par des miradors militaires et constamment menacés de démolition ou de saisie. Dans ce contexte, l’agriculture n’est plus un moyen de subsistance ordinaire, elle est devenue un acte politiquement chargé. Chaque parcelle cultivée, chaque récolte tirée d’un sol menacé, témoigne de la persistance et du refus de disparaître. Confrontés à l’isolement, à la destruction et à l’exclusion, les agriculteurs insistent pour rester, planter, nourrir et renouveler leur lien avec la terre dans le cadre de la lutte palestinienne plus large pour la liberté et l’autodétermination.
Cette résistance quotidienne va au-delà des restrictions militaires et comprend le refus d’accès, la destruction des infrastructures, la confiscation des outils et l’obstruction des marchés. Selon l’Institute for Middle East Studies (IMES, 2024), plus de 70 % des agriculteurs de la zone C ont déclaré avoir fait face à des obstacles directs ou à des attaques qui ont perturbé ou endommagé leur travail au cours de l’année écoulée.

(AP Photo/Majdi Mohammed)
Face à l’escalade des pressions et aux privations systémiques, de nombreuses communautés agricoles palestiniennes se tournent à nouveau vers les connaissances agricoles traditionnelles issues de générations d’expérience. La banque de semences créée par l’Union des comités de travail agricole (UAWC), qui préserve et distribue des variétés de semences locales résistantes à la sécheresse, est au cœur de cette renaissance. Ces semences conservées, échangées et cultivées en dehors du contrôle des entreprises israéliennes et multinationales sont devenues des symboles vivants de souveraineté alimentaire et de défi, permettant aux agriculteurs palestiniens de reprendre le contrôle de ce qu’ils cultivent et de la manière dont ils le cultivent. Ce faisant, ils résistent à la dépendance imposée par les systèmes d’intrants externes et affirment un avenir agricole local fondé sur la résilience, la mémoire et l’autonomie.
Parallèlement à ces efforts, les agriculteurs se réapproprient la collecte des eaux de pluie, l’agriculture en zone aride, les terrasses en pierre et les méthodes agroécologiques à faible coût. Il s’agit là de réponses stratégiques et régénératrices aux restrictions israéliennes en matière d’eau. Selon l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED, 2024), 44 % des agriculteurs palestiniens vivant dans des zones restreintes ou fermées ont adopté au moins une technique traditionnelle au cours de l’année écoulée, non seulement pour survivre, mais aussi pour continuer à cultiver sous le siège.
La souveraineté alimentaire dans le contexte palestinien n’est pas un slogan. Il s’agit d’une affirmation vécue, quotidienne, qui remet en question les systèmes de déplacement et d’effacement, reconnecte les communautés à leur terre et redéfinit la survie non pas en dépit de l’occupation, mais en résistance à celle-ci.
L’agriculture, une ligne de front dans la lutte pour la libération
En Palestine, l’agriculture ne se pratique pas dans des conditions normales. Elle se fait en état de siège, à l’ombre des bulldozers et sous la menace quotidienne de eradication. Ce qui se passe dans les communautés rurales est un effort calculé pour arracher les gens à leur terre, pour vider la campagne de ses habitants et pour briser la volonté collective à l’aide des outils coordonnés que sont la saisie, l’incendie criminel, le blocus et la faim.
Pourtant, la terre continue d’être cultivée comme un acte de détermination. Ceux qui plantent aujourd’hui ne sont pas simplement à la recherche d’une récolte, ils s’accrochent à une lignée, affirmant par leur travail que la terre ne se mesure pas en hectares mais en dignité, en mémoire et en vie elle-même. Chaque saison travaillée par des mains palestiniennes écrit une nouvelle ligne dans l’histoire continue du défi.
Dans ce contexte, l’Union des comités de travail agricole (UAWC) construit une réalité différente. Son travail consiste à défendre les ressources, à récupérer les terres, à renforcer la souveraineté alimentaire et à replacer la vie agricole dans un cadre de résistance et de survie. Que ce soit en préservant les semences autochtones, en soutenant la production agroécologique ou en créant des coopératives dirigées par des agriculteurs, l’UAWC aide les communautés à survivre en leur donnant une structure, une force et une raison d’être.

L’agriculture en Palestine est une décision délibérée et quotidienne de rester enraciné. Chaque acte de culture sous l’occupation déclare que la terre ne sera pas abandonnée, même lorsqu’elle est clôturée, bombardée ou saisie. Dans cette lutte, l’agriculture devient plus qu’une production alimentaire, elle devient une politique, une protection et un moyen d’aller de l’avant.
Les Palestiniens plantent leur avenir, tiennent bon et défient le monde de voir à quoi ressemble vraiment une résistance enracinée. Et en cela, il y a un appel non seulement à la solidarité, mais aussi à l’engagement commun.