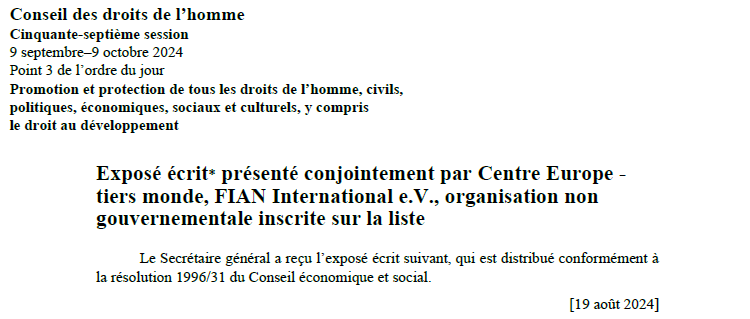Rapprocher ou exclure ? La participation des paysan.ne.s à la numérisation de l’agroécologie
image: https://revolve.media/beyond/what-is-agroecology
Cet article fournit un résumé d’un article académique rédigé par Romberg de Sá Gondim (disponible en anglais ici).
Introduction
Les outils numériques ayant tendance à intégrer une approche descendante et axée sur les entreprises, ces technologies ont été facilement assimilées par les grandes exploitations agricoles, en particulier dans le cadre de la révolution verte (Shelton et al., 2022). D’autre part, les paysan.ne.s et les petits agriculteurs sont confrontés à des inégalités en matière d’accès, de capacité à trouver et à tirer profit de ces technologies (McCampbell et al., 2025). La complexité et l’approche technocratique des technologies risquent également de minimiser la participation, l’action et la co-création de connaissances des paysan.ne.sen reproduisant (Hilbeck et Tiselli, 2020), voire en remplaçant les interactions sociales horizontales et inclusives qui existaient auparavant entre les petits agriculteurs, les paysan.ne.set les communautés rurales, menaçant ainsi un élément fondamental de l’agroécologie (Shelton et al., 2022). Si l’alphabétisation, la participation et l’accès à la technologie des paysan.ne.sne sont pas des dilemmes nouveaux dans les études agroécologiques, l’essor de la révolution numérique apporte de nouvelles nuances. Plus précisément, sur la manière dont les technologies numériques émergentes prennent ou non en compte les principes agroécologiques (Ajena et al, 2020). Cette dynamique soulève des questions fondamentales sur les droits des paysan.ne.s, et en particulier le droit de développer des pratiques agroécologiques, qui sont consacrés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).
L’impact de la numérisation sur les droits des paysan.ne.s
Les effets de la numérisation sur la co-création de connaissances et l’action des paysan.ne.s dans le domaine de l’agroécologie restent mal compris, non seulement dans la littérature universitaire, mais aussi parmi les communautés paysannes et les militants agroécologiques eux-mêmes (Silva, 2022). Des tensions apparaissent entre les approches agrotechnologiques et agroécologiques, car les premières reproduisent souvent le discours et les pratiques de la révolution verte, ce qui est en contradiction avec les approches agroécologiques et les droits des paysan.ne.s. Les outils numériques ont été associés à la dévalorisation des systèmes de connaissances traditionnels, à la standardisation des pratiques par la datafication (Ajena et al., 2022 ; Shelton et al., 2022) et à l’émergence de dynamiques prédatrices en matière de propriété intellectuelle, telles que le séquençage numérique du matériel génétique (Vogliano et al., 2021). Ces pratiques sont non seulement contraires aux valeurs agroécologiques, mais elles enfreignent également les dispositions clés de l’UNDROP, notamment l’article 19 sur le droit aux semences, l’article 20 sur la biodiversité et l’article 26 sur les connaissances traditionnelles. Pourtant, d’autres chercheurs affirment que l’agroécologie et les technologies numériques ne sont pas intrinsèquement incompatibles et que ces technologies peuvent favoriser l’évolutivité de l’agroécologie (Rotz et al., 2019), ce qui peut également créer des problèmes d’inégalité, car l’accès différencié à ces outils peut exacerber les inégalités entre les paysan.ne.s, générant des gains de productivité asymétriques qui profitent aux adoptants tout en excluant les non-adoptants (Brunori, 2024).
Compte tenu de la dynamique complexe entre la numérisation, l’agroécologie et l’action et la participation des paysan.ne.s, ce document de recherche a exploré ces thèmes à travers la question centrale suivante : dans quelle mesure les outils numériques permettent-ils ou limitent-ils une participation significative aux transitions agroécologiques au niveau territorial ? Pour y répondre, trois sous-questions ont été posées : (i) Quelles tensions et opportunités émergent dans la numérisation de l’agriculture pour les petits agriculteurs ? (ii) Comment les outils numériques s’alignent-ils ou entrent-ils en conflit avec les principes agroécologiques tels que la co-création de connaissances et la gouvernance résiliente ? ; et (iii) Qui sont les acteurs impliqués dans la conception et la gouvernance des outils numériques agroécologiques, et comment leurs approches participatives affectent-elles l’action et l’inclusion des paysan.ne.s ?
Pour répondre à ces questions, le document a également été structuré en trois parties. Tout d’abord, une analyse documentaire aborde les sous-questions à l’aide d’articles universitaires, de notes d’orientation et de rapports de programme sur la numérisation de l’agroécologie. Elle comprend une analyse descriptive d’un ensemble de données sur la manière dont les outils numériques intègrent des éléments agroécologiques et d’inclusion sociale (tiré de Dittmer et al., 2022a). Ensuite, deux sections basées sur des études de cas ont exploré : (i) les outils numériques comme moyen de co-création et de partage des connaissances, en se concentrant sur l’application Solis développée à Pará, au Brésil, dans le cadre du volet « Outils numériques inclusifs » (ADTD) du programme « Transitions agroécologiques pour la construction de systèmes agricoles et alimentaires résilients et inclusifs » (TRANSITIONS), financé par l’Union européenne (UE). Et (ii) les perspectives de gouvernance s’appuyant sur des entretiens semi-structurés menés par l’auteur avec des militants agroécologiques de La Via Campesina au Brésil et au Paraguay, ainsi que sur les conclusions des entretiens TRANSITIONS avec des acteurs politiques et techniques et des petits agriculteurs avant la mise en œuvre de Solis (Freixêdas et al., 2022). Enfin, la conclusion revient sur les résultats et les limites de la littérature existante et sur la manière dont les études de cas répondent aux questions de recherche.
Dans ce résumé, les principales conclusions des études de cas et les conclusions clés de l’article sont présentées ci-dessous. Pour plus de détails, y compris des références supplémentaires aux entretiens menés avec les dirigeants de La Via Campesina en Amérique du Sud, Perla Alvarez (CONAMURI, Paraguay) et Marciano Toledo (MPA, Brésil), veuillez vous référer à l’article complet [insérer à nouveau le lien].
Études de cas
Tout d’abord, une section sur la co-conception et la mise en œuvre de Solis, une application conçue pour accroître l’autonomie numérique des paysan.ne.s dans le petit élevage, initialement dans les villes de Novo Repartimento, Anapú et Pacajá (État de Pará, nord du Brésil). Cette section a mis en évidence la manière dont les petits agriculteurs ont été inclus, ainsi que les défis rencontrés pendant et après le processus, à travers l’analyse documentaire de rapports et de présentations sur le programme. Une deuxième session a abordé les questions de gouvernance liées à l’inclusion des paysan.ne.s et des éléments agroécologiques dans la numérisation de l’agriculture au Brésil. À cette fin, l’analyse documentaire des publications et des entretiens menés par le programme Transitions au Brésil avec des agents des ministères, des agences gouvernementales, des gouvernements des États, des coopératives, des promoteurs, du secteur privé et des ONG (Freixêdas et al., 2022) sera complétée par des entretiens menés par l’auteur avec des paysan.ne.s et des militants sociaux au sein de La Via Campesina International au Brésil et au Paraguay (également représentante de la Coordination latino-américaine des organisations rurales – CLOC).
L’application Solis, un projet développé dans la région du Pará au Brésil, est un exemple éloquent de la manière dont les outils numériques peuvent être conçus pour s’aligner sur les principes agroécologiques. Une organisation de la société civile, Solidaridad Latinoamerica, s’est associée à des paysan.ne.s qui avaient peu accès à l’assistance technique mais qui étaient déjà familiarisés avec les smartphones et les réseaux sociaux comme WhatsApp. Au lieu de présenter un produit fini, le projet a utilisé des méthodes participatives telles que des ateliers de co-création et des journées sur le terrain afin d’impliquer les paysan.ne.s dans le processus de conception dès le début. Cette approche a été cruciale pour adapter l’application aux besoins locaux. Par exemple, les contributions des paysan.ne.s ont transformé le concept initial de l’application, conduisant à la création d’une communauté d’apprentissage numérique où les utilisateurs pouvaient partager des vidéos et du contenu sur les pratiques agroécologiques locales. Cet échange de connaissances entre paysan.ne.s, principe fondamental de l’agroécologie, est devenu une caractéristique centrale. Ce processus de co-conception est conforme aux articles 10 et 18 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysan.ne.s, qui établissent le droit des paysan.ne.s à participer de manière significative à la prise de décision et au contrôle de leurs ressources.
L’application démontre que les outils numériques inclusifs peuvent autonomiser les paysan.ne.s et les aider à passer à des modèles plus agroécologiques. Cependant, elle met également en évidence des défis importants. Le processus de conception participative approfondi a retardé le lancement de l’application d’un an, et la nécessité de maintenir la gratuité de l’outil pour les paysan.ne.s impose une charge financière à ses développeurs. Cela soulève d’autres questions : comment ces initiatives précieuses, centrées sur les paysan.ne.s, peuvent-elles être maintenues et développées sans compromettre leurs principes fondamentaux ?
De plus, si des initiatives locales telles que Solis sont très prometteuses, le paysage général de la gouvernance numérique au Brésil et en Amérique latine en général est beaucoup plus difficile. Les entretiens menés par l’équipe Solis avec des représentants du gouvernement et de l’industrie ont révélé que de nombreux outils numériques existants sont conçus selon une approche « universelle » qui ne tient pas compte des besoins diversifiés des paysan.ne.s et des petits agriculteurs. Bien que certains responsables aient reconnu la nécessité de la contribution des paysan.ne.s, leur définition de la « participation » se limitait souvent à simplement consulter les paysan.ne.s ou à leur communiquer les politiques existantes. L’idée que les paysan.ne.s puissent être co-développeurs ou participants à la gouvernance administrative était rarement mentionnée.
Ce décalage est une préoccupation majeure pour les mouvements agroécologiques tels que La Via Campesina. Les entretiens menés par l’auteur avec des militants du Brésil et du Paraguay ont révélé un certain scepticisme à l’égard de l’agriculture numérique. Il ne s’agit pas d’un rejet de la technologie en soi, mais de l’approche descendante et corporatiste de nombreux outils numériques qui conduisent aux mêmes problèmes que la révolution verte. Il est intéressant de noter que les entretiens ont montré un lien entre la propriété des données et les formes antérieures de privatisation des ressources, telles que l’appropriation par les entreprises et le brevetage des variétés végétales locales. Aujourd’hui, la préoccupation est de savoir « que feront-ils de mes données ? » et « comment sont-elles utilisées ? », ce qui renforce l’importance de l’UNDROP en mettant l’accent sur les droits des paysan.ne.s à contrôler leurs propres ressources et leurs connaissances traditionnelles. En outre, d’autres défis dans le contexte latino-américain, tels que le manque d’accès sécurisé à la terre, un paysage politique public fragmenté et opaque, et les luttes actuelles sur les droits des semences, sont prioritaires pour les mouvements sociaux, qui détournent leur attention des débats actuels sur la numérisation.
En fin de compte, la recherche montre un écart évident entre le potentiel des outils numériques pour favoriser l’agroécologie et la réalité de leur conception et de leur gouvernance actuelles. Si des initiatives locales telles que Solis créent des alternatives inclusives, elles fonctionnent en parallèle d’un environnement politique plus large qui exclut largement les mouvements paysan.ne.s et ne traite pas les questions fondamentales du pouvoir, de la participation et de la souveraineté des données.
Conclusion
Cet article visait à comprendre dans quelle mesure les technologies numériques permettent ou limitent une participation significative aux transitions agroécologiques au niveau territorial. Les résultats confirment de nombreuses préoccupations critiques soulevées dans la littérature universitaire. Bien qu’il mentionne la possibilité de co-créer des outils numériques à des fins agroécologiques, la plupart des outils actuels répertoriés sont loin d’intégrer les principes agroécologiques et l’inclusion sociale dans leur conception (Dittmer et al., 2022a). Ainsi, l’approche dominante, descendante et axée sur les entreprises, pourrait continuer à façonner la plupart des outils agricoles numériques, en les intégrant dans les discours sur la normalisation et la productivité associés à la révolution verte (Klerkx & Rose, 2020 ; Shelton et al., 2022). Ces modèles ont tendance à marginaliser les petits exploitants, à exclure les connaissances traditionnelles et risquent d’aggraver les inégalités. Si les relations de pouvoir sont soulignées dans la littérature, peu de choses sont mentionnées sur le rôle du mouvement paysan dans la numérisation de l’agriculture, en dehors des préoccupations légitimes concernant la propriété des données paysannes et la vision des entreprises derrière ces outils. Leur engagement dans la co-création d’outils numériques horizontaux n’est pas encore clair.
Les recherches futures devraient être approfondies et élargies, notamment sur des thèmes tels que le financement des outils numériques en agroécologie, afin de comprendre leur modèle opérationnel – et la manière dont les connaissances paysannes y sont intégrées –, le retour sur investissement, et d’identifier les différents mécanismes financiers qui pourraient être liés à davantage d’éléments agroécologiques et à la réalisation de l’inclusion sociale, c’est-à-dire à une plus grande participation. En outre, les prochaines recherches devraient se concentrer sur le rôle des mouvements paysan.ne.s dans la co-création, la mise en œuvre ou même la résistance aux technologies numériques, et sur la compréhension de la manière dont ces acteurs influencent la gouvernance – au niveau local ou national, institutionnalisée ou non – et les valeurs inhérentes aux technologies numériques, ce qui est essentiel pour une transition numérique plus démocratique. Compte tenu de la date de rédaction, l’article n’a pas intégré les efforts récents, tels que le projet « Inteligência Artificial da Reforma Agrária e Agroecologia » (IARAA, IA de la réforme agraire et de l’agroécologie), coordonné par le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre et la Marche mondiale des femmes.
En fin de compte, si l’agroécologie doit servir d’alternative à l’agriculture industrielle et productiviste, son engagement avec les outils numériques ne doit pas reproduire les structures mêmes qu’elle cherche à remplacer. Elle doit au contraire être repensée de fond en comble, en s’appuyant sur l’action des paysan.ne.s, les connaissances collectives et une gouvernance équitable (Laurens et al., 2023 ; McCampbell et al., 2025 ; Sheldon et al., 2022), afin de respecter les droits reconnus dans la UNDROP. Cela inclut, mais va au-delà de la conception inclusive, la compréhension de la gouvernance et des dynamiques de pouvoir (Rosset et al., 2025 ; Rotz et al., 2019). Alors que les technologies numériques s’intègrent rapidement dans les systèmes alimentaires et agricoles, cet article a souligné que le défi n’est pas seulement technologique, mais qu’il concerne fondamentalement le pouvoir, la participation et l’avenir de l’agroécologie, ses pratiques, ses principes et ses acteurs.
Pour consulter les références bibliographiques citées dans cet article, veuillez vous référer à l’article complet fourni ci-dessous.
À ce sujet, lire aussi :
1.) https://www.eurovia.org/fr/publications/les-defis-de-la-numerisation-pour-lagroecologie-paysanne/
2.) https://defendingpeasantsrights.org/fr/les-defis-du-mouvement-paysan-face-a-la-digitalisation-de-lagriculture/