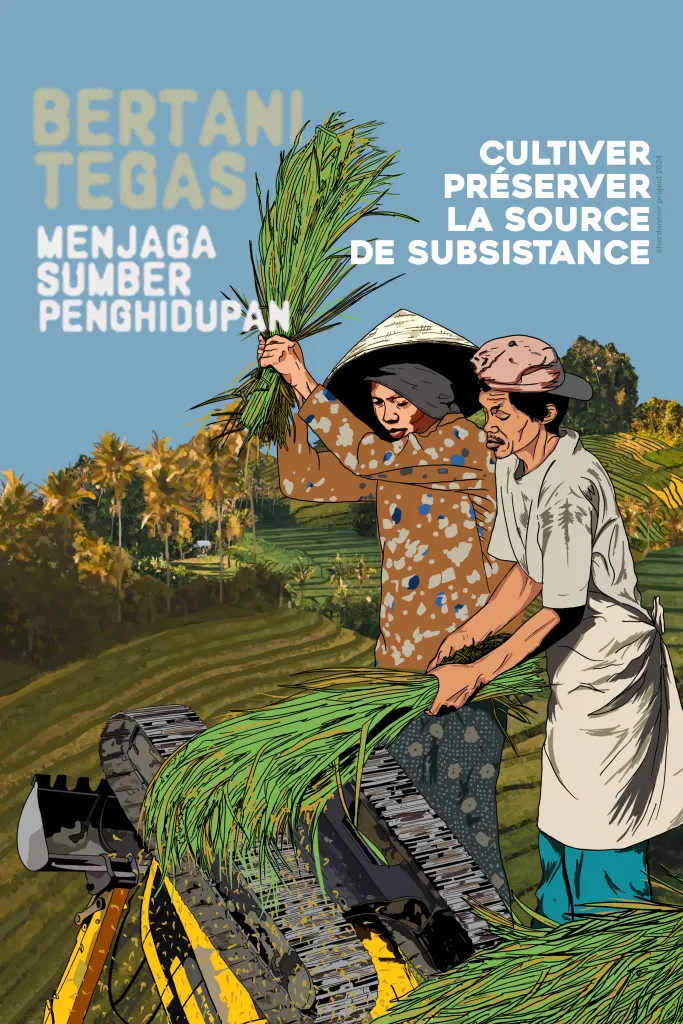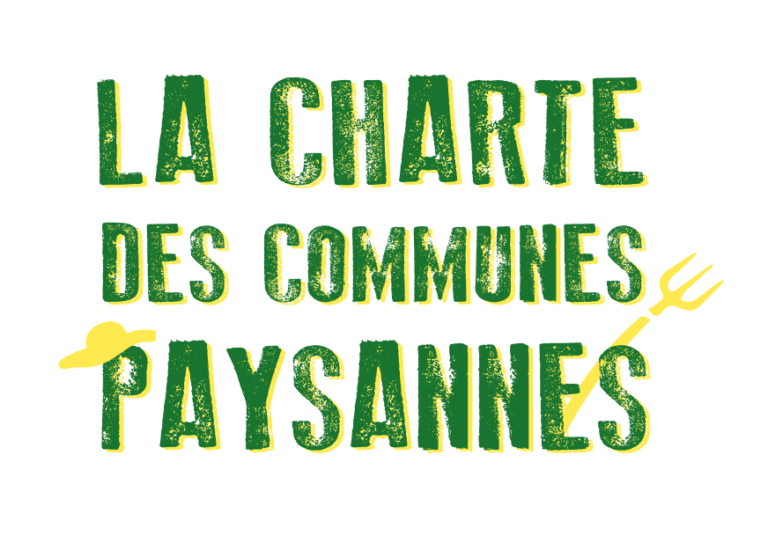Synergies et complémentarité entre l’agroécologie et l’UNDROP : l’exemple du Brésil
Photo: MST (Brésil)
Cet article s’appuie sur l’exemple du Brésil pour illustrer les synergies et les complémentarités entre l’agroécologie et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).
Que voulons-nous dire concrètement par agroécologie ? En résumé, on pourrait dire que l’agroécologie est un projet de vie pour plus de vie en harmonie avec la nature. Toutefois, il existe aujourd’hui aussi de nombreuses interprétations de ce concept. L’agroécologie semble être devenue à la mode dans le monde entier, surtout après que le Brésilien José Graziano da Silva, en tant que Directeur général de la FAO, y a ouvert « une fenêtre dans la cathédrale de la Révolution verte ». Quel est le problème lorsqu’un terme devient à la mode ? C’est que les gens essaient de l’utiliser pour presque tout. Si, par exemple, nous partons d’un concept de l’agroécologie réduit à la science, alors il existe un danger de la négliger en tant que pratique agricole et en tant que mouvement social ! Nous pourrions alors l’imaginer comme quelque chose qui découle davantage d’une activité académique. Elle devient ainsi réduite à une matière de science agricole, et pourrait aussi être appelée autrement.
Pour nous, toutefois, l’agroécologie est avant tout une pratique agricole. Et si l’agroécologie peut être un chemin vers la souveraineté alimentaire, alors nous devons clairement nous demander si elle est pratiquée avec ou sans paysans. Après tout, l’agroécologie est née en Amérique latine comme une réponse paysanne aux effets négatifs de la soi-disant Révolution verte. Les paysans et paysannes devraient donc avoir un rôle central dans l’agroécologie.
L’UNDROP affirme clairement l’obligation des États de promouvoir la production agroécologique (article 16.4), d’adopter des mesures appropriées pour la conservation et l’utilisation durable des terres et des ressources naturelles à travers l’agroécologie (article 17.7) et de protéger et promouvoir les connaissances traditionnelles des communautés rurales, en particulier les pratiques agroécologiques essentielles à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité (article 20.2). Elle consacre également le droit des paysans et paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales à recevoir une formation adéquate, adaptée à leurs contextes agroécologiques, socioculturels et économiques spécifiques (article 25.1).
La souveraineté alimentaire – consacrée comme un droit des communautés rurales dans l’article 15.4 de l’UNDROP – concerne la production alimentaire. Et l’agroécologie concerne les paysans et paysannes. En d’autres termes, il s’agit d’agriculture. Cependant, l’agriculture ne doit pas être réduite à l’économie. L’agriculture est aussi de la culture, c’est-à-dire de l’agri-culture. Et la culture, c’est la connaissance. C’est la nourriture. C’est l’histoire. Et c’est la vie ! Et c’est là que le problème de la science agricole entre en jeu. Car les communautés paysannes et les peuples autochtones voient encore le monde comme un tout. Lorsqu’un paysan ou une paysanne cultive toutes sortes de plantes, c’est aussi parce qu’il/elle peut s’en nourrir ! Il est important de réaliser que les paysans et paysannes existent depuis 10’000 ans et que beaucoup d’entre eux/elles ont réussi à être autosuffisants !
Ainsi, si tout le reste échoue, les paysans et paysannes ont toujours leur propre nourriture ! C’est la seule profession qui peut le revendiquer. Un cordonnier mangera-t-il des chaussures, par exemple ? Ou un tailleur mangera-t-il des vêtements ? Non. Seuls les paysans et paysannes ont cette autonomie. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Cela devrait signifier décider de ce qui est produit, de qui le produit, pour qui il est produit, comment il est produit (certaines personnes pensent que l’agroécologie concerne seulement le « comment ») et pourquoi un aliment est produit.
Si nous contrôlons les réponses à ces cinq questions (c’est-à-dire quoi, qui, pour qui, comment et pourquoi), alors nous avons la souveraineté alimentaire. C’est le pouvoir local. C’est l’autodétermination. L’agroécologie peut-elle contribuer à renforcer les droits des paysans et paysannes et la souveraineté alimentaire ? Oui, elle le peut !
Je vais présenter dix raisons pour lesquelles l’agriculture familiale et paysanne devrait pratiquer l’agroécologie au Brésil et dans d’autres pays, en établissant des liens avec les droits énoncés dans l’UNDROP.
1. L’agroécologie réduit les coûts de production en agriculture. Nous avons déjà observé une réduction des coûts d’exploitation allant jusqu’à 40 % dans l’agriculture biologique. Cela contribue directement à une augmentation du revenu final des paysans et paysannes, conformément à leur droit à un revenu décent reconnu à l’article 16 de l’UNDROP.
2. L’agroécologie améliore la conservation des ressources naturelles. En 1713, Hans Carl von Carlowitz a écrit un livre intitulé « Sylvicultura Oeconomica ». Carlowitz croyait que la durabilité signifiait ne pas prélever plus de bois dans une forêt qu’elle ne pouvait en repousser. Cette idée, selon laquelle les forestiers ne devraient pas prélever plus d’arbres que la forêt ne peut en régénérer, est la même que celle des pêcheurs qui savent qu’ils ne doivent pas attraper plus de poissons que la nature ne peut en reconstituer. Cela correspond à la philosophie de durabilité de la plupart des peuples autochtones !
Pourquoi cet exemple est-il pertinent pour l’agroécologie ? Parce que l’idée de l’agroforesterie nous permet d’aller au-delà de l’agroécologie. Je pense que le modèle qui se rapproche le plus de la nature est la forêt. Mais s’il vous plaît, pas de monocultures de pins ou d’eucalyptus ! Les forêts sont diversifiées. Et l’agriculture industrielle ne peut pas utiliser les ressources naturelles de manière durable. Selon ce modèle, tout doit être produit aussi vite et autant que possible. La nature est ainsi surchargée et détruite. Et que se passe-t-il alors ? Alors les investissements sont faits ailleurs. Préserver les ressources naturelles signifie considérer l’eau, le sol et la vie dans le sol comme essentiels pour l’agriculture, ce qui correspond aussi aux droits des paysans et paysannes énoncés aux articles 17 (droit à la terre), 18 (droit à l’environnement) et 21 (droit à l’eau) de l’UNDROP. Chaque famille paysanne veut que son fils, sa fille, ses petits-enfants et arrière petits-enfants continuent à cultiver. Ainsi, ils ne penseront pas nécessairement qu’ils plantent un arbre pour l’utiliser immédiatement. Dans 100 ans, ce sera peut-être leur petit-enfant qui l’utilisera. Voilà l’idée derrière la préservation des ressources naturelles. Une agriculture adaptée aux petits-enfants !
3. L’agroécologie est capable de mieux rémunérer le travail des personnes dans les zones rurales. Mais comment y parvenir ? Tout d’abord, l’utilisation de technologies agricoles économisant du travail augmente le temps non travaillé, car la dépendance à la nature signifie que le temps de production en agriculture est distinct du temps de travail nécessaire. Si moins de travail est requis pour la production mais que le temps d’attente jusqu’à la récolte reste le même, cela crée soit du temps libre, soit plus de temps pour d’autres activités. Et comment les familles paysannes utiliseront-elles ce temps ? Au minimum, la production devra être diversifiée. Avec l’agroécologie, il est impossible de pratiquer la monoculture. Le succès de l’agroécologie est donc étroitement lié au concept de multifonctionnalité en agriculture, ce qui signifie que le travail peut être mieux rémunéré. Une meilleure rémunération du travail signifie que les paysans et paysannes reçoivent finalement plus pour leur travail. Normalement, ils ne tiennent même pas compte de ces coûts. Mais n’est-ce pas précisément le travail qui crée la valeur des biens ? Et si vous préservez la nature, ne devriez-vous pas être mieux rémunéré pour cela ? Oui ! Il existe déjà des endroits dans le monde où les paysans et paysannes sont récompensés pour cela. Ils/elles sont rémunérés par la société parce que, par exemple, une agriculture respectueuse de la nature signifie des coûts de santé publique plus faibles. Chaque communauté peut le faire. Si nous utilisons moins de pesticides, si nous évitons les OGM, nous aurons moins de problèmes de santé et moins de dépenses publiques. Donc, oui : il est possible de mieux rémunérer celles et ceux qui travaillent avec l’agroécologie, conformément à l’article 16 de l’UNDROP, qui protège le droit des paysans et paysannes à un revenu décent et à un niveau de vie adéquat. Mais cela demande plus de connaissances, et c’est un autre défi. Le temps libéré par l’agroécologie peut aussi être consacré au développement des connaissances.
4. L’agroécologie est un moyen d’optimiser les écosystèmes agricoles. Il est possible de réduire les intrants externes en agriculture grâce à l’agroécologie. Avec l’agroécologie, la production est de plus en plus locale et en cycles fermés avec moins de gaspillage d’énergie, ce qui réduit également la dépendance aux longs trajets. Cela réduit l’impact négatif sur l’environnement, conformément à l’article 18 de l’UNDROP. Avec l’agroécologie, il est possible de réduire l’érosion, le lessivage des sols et la désertification.
5. L’agroécologie permet d’augmenter la production, ce qui est important pour réaliser les articles 16 et 15 de l’UNDROP. Par exemple, grâce aux cultures associées, qui prospèrent particulièrement bien dans les climats tropicaux. Au Brésil, par exemple, cultiver du maïs et des haricots dans le même champ donne finalement un rendement supérieur à celui du seul maïs. Les cultures associées produisent des rendements plus élevés sur la même superficie. L’intensification écologique est une solution, en particulier dans les pays disposant de terres arables limitées. Et cette solution est déjà pratiquée dans de nombreux endroits, y compris par la FAO. Cela nous donne un avantage. Mais nous devrions être un peu prudents, car la productivité peut diminuer au cours des premières années. L’équilibre doit d’abord être rétabli. Il est nécessaire de constituer de l’humus dans le sol et de privilégier les plantes avec des racines diversifiées permettant la circulation de l’eau, de l’air et de la matière organique. Alors le sol se régénère. Pendant ces années initiales, les gouvernements devraient aider les paysans et paysannes. Car à court terme, l’agroécologie peut entraîner une diminution de la productivité. Mais à moyen et long termes, elle peut en réalité produire plus que le modèle industriel. Il existe de nombreux témoignages de paysans et paysannes au Brésil qui l’ont déjà prouvé.
6. Les jeunes et les femmes sont protagonistes du processus agroécologique. Et c’est très important pour les droits des personnes dans les zones rurales et leur avenir. Ainsi, quand nous parlons de paysans, nous devons aussi parler des jeunes paysans, et surtout des jeunes paysannes, conformément à l’article 4 de l’UNDROP sur les droits des femmes rurales.
7. Il y a un autre aspect de l’agriculture à petite échelle qui est cohérent avec le concept d’agroécologie : c’est la relation particulière que les familles paysannes entretiennent avec la connaissance. Les familles paysannes échangent leurs découvertes, elles partagent leurs connaissances, elles les transmettent. Au lieu de les garder pour elles-mêmes, les paysans et paysannes diffusent leurs savoirs au sein d’une communauté, et ce faisant, ils réalisent l’article 26 de l’UNDROP sur le droit à la culture et aux connaissances traditionnelles.
8. Il existe diverses manières de faire la transition vers l’agroécologie, et les États devraient prendre des mesures appropriées pour s’assurer que leurs programmes et politiques contribuent effectivement à la transition vers des modèles agricoles durables, comme stipulé à l’article 16.4 de l’UNDROP. L’agroécologie peut servir de parapluie sous lequel diverses formes d’agriculture sont promues – dont beaucoup que nous ne connaissons pas encore car nous n’avons pas encore établi de contacts avec de nombreux peuples autochtones qui pratiquent l’agriculture. Ce type d’agriculture peut être identifié comme faisant partie de ce que nous appelons habituellement « agroécologique ». C’est un type d’agriculture qui pourrait être décrit comme traditionnel, mais il n’est pas seulement cela. Il est aussi innovant. Et il nous aidera à atteindre ces 10 objectifs que nous présentons ici, et à réaliser la souveraineté alimentaire.
9. Une innovation importante que nous devons mettre en œuvre est de garantir l’accès aux marchés (consacré aux articles 2.6e et 16.3 de l’UNDROP) ainsi que la formation et l’information sur les marchés (articles 11 et 25). Dans le passé, les paysans et paysannes n’étaient pas capables de réaliser cette innovation par eux-mêmes. Mais nous avons de bons exemples de cela au Brésil avec des programmes gouvernementaux. Par exemple, avec le programme d’alimentation scolaire et les achats publics, par lesquels la nourriture est achetée directement auprès d’organisations paysannes locales et régionales. Ces initiatives ont conduit à ce que le Brésil soit retiré de la carte de la faim de l’ONU en 2014. Cependant, après six ans de gouvernements conservateurs qui ont démantelé ces politiques, la faim est revenue en nombre alarmant en 2022, avec plus de 15 % de la population souffrant de faim aiguë – la plupart dans les zones rurales ! Plus récemment, grâce aux efforts renouvelés du gouvernement actuel, le Brésil a de nouveau été retiré de la carte de la faim en 2025.
Ces marchés institutionnels soutiennent la transition agroécologique. L’organisation entre paysans et consommateurs permet aussi à la nourriture biologique d’arriver sur les tables des gens, ce qui est un élément important de la souveraineté alimentaire. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de sécurité alimentaire, car la sécurité alimentaire peut signifier que quelqu’un d’autre vous nourrit. Bien sûr, si quelqu’un meurt de faim, il doit recevoir de la nourriture. Mais c’est une urgence. Personne ne devrait en être dépendant. Ce serait encore pire de rendre les familles paysannes dépendantes de cela. Si nous pouvons produire, transformer et commercialiser la nourriture le plus près possible du lieu de production, les familles paysannes seront aussi mieux nourries. Et cela améliore aussi la souveraineté alimentaire. Lorsqu’elles produisent pour la région, cela augmente aussi la disponibilité de nourriture locale. Voilà ce que l’agroécologie peut accomplir. La sécurité alimentaire signifie la disponibilité de nourriture en termes de quantité, de qualité et de régularité tout au long de l’année. Mais ce n’est pas tout ! Nous devons aussi savoir qui produira cette nourriture ? Quels types de nourriture seront produits ? Avec quelle technologie ? Avec l’utilisation de pesticides et du génie génétique, ou non ? Une agriculture sans personnes n’est pas non plus de l’agroécologie. L’agroécologie est une agriculture avec des personnes et pour des personnes en harmonie avec la nature.
10. Mais pour ce faire, nous devons utiliser les dernières découvertes scientifiques. Mais attention : il y a des intérêts derrière la science moderne. Elle n’est pas neutre en valeur ! Lorsqu’il s’agit de science au service de l’agroécologie, nous devons nous souvenir que sans la science moderne que nous avons eue jusqu’à présent, l’industrialisation de l’agriculture n’aurait pas été possible. Donc, elle n’est pas innocente. La science qui doit servir l’agroécologie doit être différente. Elle doit être dépendante du contexte et transdisciplinaire, réunissant savoirs traditionnels et scientifiques.
Cette science ne doit pas être oppressive ni empreinte de préjugés, et surtout, elle ne doit pas déplacer les gens de leur terre et de leur maison. Nous devons éviter cela, ainsi que les pandémies, les famines, les crises climatiques. La véritable réponse à cela est liée à notre alimentation, la bonne nourriture et la souveraineté alimentaire.
L’agroécologie concerne la vraie nourriture produite par les paysans et paysannes, l’agriculture biologique et les peuples traditionnels.
L’UNDROP renforce les multiples principes de l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire. Elle confirme la primauté des droits des paysans et paysannes et des autres communautés rurales, et rappelle aux États leur obligation de respecter, protéger et réaliser ces droits. Pourquoi est-ce important ? Parce que nous voulons que l’humanité continue d’exister après nous.