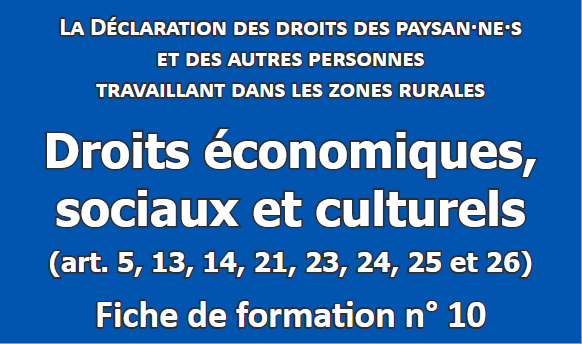Colombie : Reconnaissance des paysan.nes dans la Constitution – Interview de Martha Elena Huertas Moya
Le 5 juillet 2023, la Colombie a réformé sa Constitution politique et tout particulièrement son article 64. L’article 64 posait, depuis 1991, le devoir pour l’État d’aider l’accès des travailleur.euses agricoles à la propriété de la terre, ainsi qu’à une série de droits permettant un meilleur niveau de vie. Ce devoir reste bien dans la nouvelle version de l’article, s’y ajoute à présent la reconnaissance de la paysannerie et des paysan.nes comme des sujets de droits spécifiques. L’article leur reconnait une identité particulière, attaché à leur relation à la terre et au territoire, de cela découle un statut spécifique en tant que sujet politique.
La paysannerie est un sujet de droits et de protection spéciale, elle a une relation particulière avec la terre fondée sur la production alimentaire comme garantie de la souveraineté alimentaire, ses formes de territorialité paysanne, ses conditions géographiques, démographiques, organisationnelles et culturelles qui la distinguent des autres groupes sociaux.
Article 64 §2 de la Constitution de la Colombie.
Cette reconnaissance est l’aboutissement d’une lutte de longue haleine de la part des paysan.nes et de leurs organisations representatives. Pour bien comprendre l’importance de ce changement dans la Constitution, comment il a été obtenu, le rôle de l’UNDROP dans ce nouvel acquis et les étapes à venir, nous avons interviewé Martha Elena Huertas Moya de l’organisation paysanne FENACOA.
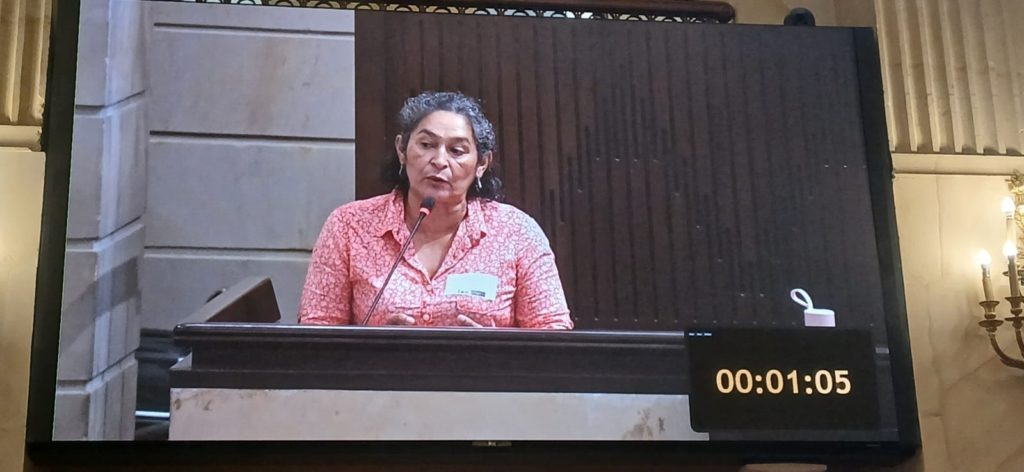
Pouvez-vous vous présenter, ainsi que votre organisation ?
Je suis Martha Elena Huertas Moya, une paysanne née dans la campagne de Bogota, j’entretiens toujours des liens avec ma communauté. Je suis membre de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENACOA), depuis sa création il y a 40 ans, en tant qu’éducatrice et, au cours de la dernière décennie, en tant que membre du conseil d’administration.
La FENACOA, regroupe des coopératives et des associations d’économie sociale et communautaire et cela dans plusieurs régions du pays, telles que Guaviare, Meta, Cundinamarca, Tolima, Cauca et Caldas.
Nous sommes une organisation qui n’a pas encore été reconnue comme victime de la violence sociopolitique et du conflit social et armé en Colombie. Dans les années 1990, deux de nos dirigeants et des leaders de beaucoup de nos organisations ont été assassinés, une autre partie de la direction a été emprisonnée, des leaders et des associés ont été menacés et exilés.
Nous sommes également une organisation membre de la CLOC LVC, depuis le tout début, et membre de plusieurs plateformes de lutte pour une réforme agraire globale en Colombie.
Notre objectif principal en tant que secteur coopératif agricole, et en particulier dans le contexte actuel du gouvernement avec son plan de développement « puissance mondiale de la vie », est de contribuer à la réactivation économique du pays dans le secteur primaire, de contribuer aux transitions agro-écologique et énergétique et aux transformations sociales et politiques nécessaires au plein exercice des droits de la paysannerie. Cette dernière a d’ailleurs été reconnue comme un sujet de protection spéciale grâce à la lutte mondiale menée par le mouvement Via Campesina.
Pouvez-vous nous parler de la situation des droits des paysan.nes en Colombie, en particulier après l’élection du Président Gustavo Petro en 2022 ?
Le président Petro et son programme de gouvernement représentent pour la paysannerie colombienne l’opportunité de :
a) être reconnue dans la Constitution comme sujet politique de droit, avec une protection spéciale, afin d’accéder à l’exercice des droits inscrits dans l’UNDROP.
b) reprendre l’application de l’accord de paix, qui prévoyait entre autres la mise en œuvre de la réforme rurale intégrale, par le biais d’objectifs concrets tels que l’achat de 3 000 000 d’hectares de terres pour l’adjudication, la formalisation, la restitution et la réparation pour la paysannerie.
c) réaliser les transformations sociales et politiques nécessaires pour que la paysannerie et les travailleurs ruraux puissent mener une vie digne.
Avez-vous constaté des progrès, par exemple en matière de réforme agraire ?
Les changements et progrès constatés depuis l’entrée en fonction de l’administration de Gustavo Petro sont clairement observables, non seulement en termes de mesures juridiques et constitutionnelles (cadres normatifs et réglementaires, lois, décrets, résolutions, etc.), mais aussi en termes de proposition de réforme de la loi agraire. Sans surprise, ces dernières sont entravées et refusées au Congrès de la République par la majorité parlementaire, représentative des intérêts latifundistes. Malgré ces obstacles, des actions politiques importantes sont mises en œuvre pour la première fois, telles que des transferts massifs de terres, le financement de projets productifs, la reconnaissance de territoires paysans. Il faut également souligner que ces initiatives sont prises sous le prisme du respect de l’environnement et des droits de la nature, éléments centraux face aux crises climatiques actuelles.
En outre, toutes les organisations de la paysannerie se sont rassemblées pour former l’Agenda national paysan. Cette formation s’est mobilisée pour porter des objectifs et propositions communes, mobilisations qui ont mené à la signature d’un accord avec le gouvernement. L’accord signé en Juillet 2024 porte sur la mise en œuvre de la réforme agraire, le développement rural, la réactivation économique, les projets productifs, la substitution de la culture de la coca et autres.
Les organisations paysannes réclament une « réforme agraire intégrale et populaire ». Qu’est-ce que cela signifie pour vous par rapport à la réforme agraire « classique » ?
La réforme agraire est le concept le plus large et le plus significatif pour la paysannerie. Il s’agit d’avoir accès à la terre, à la propriété de cette terre, dans un pays où la propriété et la jouissance de la terre sont détenues par de grands propriétaires terriens et par des corporations de producteurs d’aliments agro-industriels. La Colombie est un pays où la (contre)réforme agraire la plus efficace a été menée par les grands propriétaires terriens et les trafiquants de drogue à travers une stratégie de dépossession des paysans de leurs terres par le biais d’expulsions et d’autres pratiques d’occupation des terres et territoires paysans, avec le soutien critique des gangs paramilitaires.
Pour la paysannerie, la réforme agraire est intégrale dans la mesure où elle garantit les conditions matérielles et immatérielles nécessaires au développement de ses projets de vie, conformément à ses caractéristiques culturelles et sociales. Cet objectif s’inscrit dans la perspective de pouvoir produire, transformer et commercialiser des aliments pour l’autoconsommation et l’approvisionnement alimentaire de l’ensemble de la population.
La réforme intégrale se réfère donc à tous ces changements et transformations structurels (modèle économique, modèle de production agricole, modèle du système de protection sociale) afin de rendre à la paysannerie l’autonomie et la souveraineté de produire des aliments à partir des postulats de l’agriculture biologique et écologique. Cela inclut aussi, bien sûr, la gestion de leurs semences et la production de tous les intrants biologiques nécessaires. En conclusion, la réforme doit être intégrale dans le sens de la garantie des droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à l’éducation, à la santé, à la protection sociale, etc.
Pouvez-vous expliquer l’importance de l’inclusion des paysan.nes en tant que sujet de droits dans la Constitution ?
Nouvel article 64 de la Constitution :
« Il est du devoir de l’État de promouvoir l’accès progressif à la propriété foncière des paysans et des travailleurs agricoles, individuellement ou en association.
La paysannerie est un sujet de droits et de protection spéciale, elle a une relation particulière avec la terre basée sur la production alimentaire comme garantie de la souveraineté alimentaire, ses formes de territorialité paysanne, ses conditions géographiques, démographiques, organisationnelles et culturelles qui la distinguent des autres groupes sociaux.
L’État reconnaît la dimension économique, sociale, culturelle, politique et environnementale de la paysannerie, ainsi que celles qui sont reconnues, et assure la protection, le respect et la garantie de ses droits individuels et collectifs, dans le but d’atteindre l’égalité matérielle selon une approche de genre, d’âge et de territoire, l’accès aux biens et aux droits tels que l’éducation de qualité et pertinente, le logement, la santé, les services publics, les routes tertiaires, la terre, le territoire, un environnement sain, l’accès et l’échange de semences, les ressources naturelles et la biodiversité, l’eau, le renforcement de la participation, la connectivité numérique, l’amélioration des infrastructures rurales, la vulgarisation agricole et commerciale, l’assistance technique et technologique pour générer de la valeur ajoutée et les moyens de commercialiser leurs produits.
Les paysans sont libres et égaux à tous les autres peuples et ont le droit de ne faire l’objet d’aucune forme de discrimination dans l’exercice de leurs droits, en particulier ceux qui sont fondés sur leur situation économique, sociale, culturelle et politique.«
En 1991, la nouvelle Constitution avait apporté des changements significatifs pour garantir un État social et de droit – après des décennies de violences et de fermeture démocratique. À partir de là, les principales libertés démocratiques ont enfin été possibles, entamant un long processus vers la justice sociale dans un pays présentant un taux d’inégalité sociale parmi les plus élevés, la plus forte concentration de propriété foncière et des indicateurs alarmants de crise humanitaire.
La Constitution de 1991 reconnaît les droits des peuples indigènes et des populations afro-
descendantes, des Roms et des Palenqueros, ainsi que les droits des minorités ethniques. Cependant, la paysannerie en était malheureusement exclue. Dans les territoires, ce manque de reconnaissance a eu un impact sérieux sur l’exercice des droits culturels, sociaux, économiques et politiques de la paysannerie, en particulier en tant que secteur subordonné, exploité et marginalisé par le classisme et racisme structurels. Le fait d’être reconnus comme des sujets de protection spéciale nous a également placés sur un pied d’égalité pour être une autre minorité ayant des droits, et ce sont ces ajustements qui sont en train d’être harmonisés au sein de la politique publique.
Quelles ont été les clés de ce changement et, plus généralement, de la mise en œuvre des droits des paysans ?
Pour la FENACOA, cette reconnaissance est due à plusieurs facteurs :
- L’inscription des points non respectés de l’accord de La Havane à l’ordre du jour public de l’État (au-delà du gouvernement).
- Avoir participé activement au mouvement social qui a mené à l’élection de ce gouvernement de changement
- Être considéré comme le plus grand secteur social ayant une dette politique importante, ainsi que comme la principale victime de la violence sociopolitique et du conflit social et armé. Avoir cette dette en suspens est nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme agraire intégrale.
- Avoir un impact dans les espaces publics, sociaux et communautaires avec la Déclaration des droits des paysans.
- Avoir une accumulation de luttes pour la réforme agraire intégrale.
Maintenant que vous avez obtenu ce changement, quelles sont, selon vous, les prochaines étapes à franchir pour mettre en œuvre l’UNDROP au niveau national ?
La droite politique colombienne a installé des magistrats, des membres du congrès et des fonctionnaires qui, pendant des décennies, ont empêché et continuent d’empêcher les changements en faveur de la paysannerie colombienne. À l’heure actuelle, ces hauts fonctionnaires sont en première ligne pour bloquer les avancées significatives de la politique agraire.
Nous rencontrons des difficultés au niveau des hautes juridictions (pouvoir judiciaire), et en particulier de la Cour constitutionnelle, qui est en train de réviser, sous pression de la droite latifundiste au Congrès, les articles sur les droits des paysans, dans un défi ouvert et clair au gouvernement de Petro . L’objectif est de bloquer le plein exercice des droits reconnus. Face à cela, nous devons mener une mobilisation sociale et politique permanente pour empêcher le recul de ces droits et pour garantir que des progrès soient réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration.
Un deuxième scénario concerne la Cour suprême de justice, où les représentants des grands propriétaires terriens exigent la révision de la juridiction agraire par cette cour, afin qu’il y ait des juges agraires pour régler directement les conflits. Il s’agit une fois de plus d’une manœuvre de la droite latifundiste pour empêcher les paysans de résoudre directement les différents conflits qu’ils peuvent avoir au sujet de la terre, des titres, des servitudes, des litiges sur l’eau, des litiges sur les frontières, entre autres.
Certaines organisations de la CLOC-LVC Colombie viennent de lancer une large mobilisation sociale afin de soutenir l’organisation l’Agenda national des paysans, au sein de laquelle un accord pour avancer dans la mise en œuvre et exécution des droits des paysans a été signé.
La pleine jouissance des droits des paysans et des travailleurs ruraux nécessite des changements structurels, et cela continuera d’être la lutte de la paysannerie et d’autres organisations sociales et populaires. Nous rappelons que le capitalisme néolibéral retarde toute tentative démocratique et sociale en Amérique latine.
Quels sont les principaux défis à relever en termes de promotion des droits des paysans et de la souveraineté alimentaire?
À court terme, les principaux défis auxquels est confronté le gouvernement national sont les suivants :
- Premièrement, mettre en place une commission mixte, qui sera le mécanisme de consultation permanente entre l’État et la paysannerie colombienne, ce qui est nécessaire pour harmoniser les politiques publiques et les structures administratives gouvernementales afin de veiller à la mise en œuvre de la réforme rurale intégrale.
- Deuxièmement, exécuter le programme du gouvernement qui répond aux besoins, aux demandes et aux attentes du secteur paysan, ce qui implique de respecter les accords passés par les gouvernements précédents.
A moyen terme :
- Mettre en place l’ensemble du système interinstitutionnel pour faire face aux transformations requises par la mise en œuvre de la réforme rurale globale.
- Créer les conditions pour mettre les avancées actuelles à l’abri d’autres gouvernements qui pourraient tenter de saper tous ces changements et transformations.
Il est également nécessaire de souligner les défis auxquels est confronté le mouvement paysan. En particulier, la consolidation et le dialogue nécessaires entre les différentes organisations paysannes, ainsi qu’au niveau de la gestion et de l’exécution des projets productifs, de la transformation, de la commercialisation, etc. de l’économie paysanne, sociale, solidaire et communautaire.
Ce défi de la consolidation implique également des stratégies et des relations d’alliance avec d’autres secteurs, avec des processus sociaux, communautaires et de consommation, en assurant une articulation permanente avec tous les secteurs sociaux du pays, afin de contribuer au renforcement de la base sociale qui contribue aux changements et aux transformations politiques dont le pays a besoin.