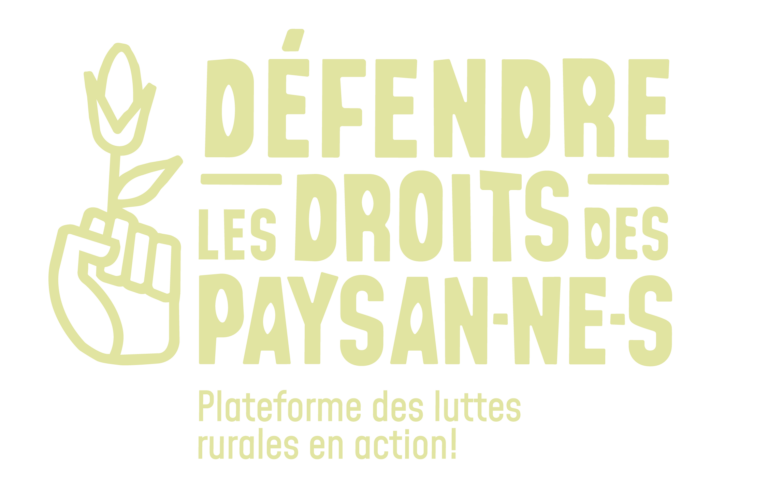Défis de la paysannerie brésilienne : L’UNDROP comme outil de lutte
Contribution de Via Campesina Brésil au Groupe de Travail de l’ONU sur la Déclaration UNDROP
Via Campesina Brésil présente une contribution écrite en réponse à l’appel du Groupe de Travail de l’ONU sur l’UNDROP, décrivant les principaux défis de la paysannerie brésilienne. Élaboré collectivement après une formation sur l’UNDROP pour les organisations brésiliennes de la LVC, le texte propose également une vision collective sur l’état actuel du droit à la participation des paysans et paysannes au Brésil.
Durant les mois de janvier et mars 2025, une formation sur la Déclaration des droits des paysans et paysannes (UNDROP) a été organisée pour les organisations membres de Via Campesina Brésil, avec le soutien de l’organisation de droits humains Terra de Direitos et du CETIM. Ce fut la première formation consacrée à l’UNDROP destinée aux mouvements sociaux et organisations rurales de base au Brésil, constituant un exemple pratique de la mise en œuvre de la stratégie de Via Campesina Internationale visant à réaliser des formations sur la Déclaration pour ses bases dans divers pays.
L’objectif de la formation était non seulement de faire connaître l’UNDROP à ses détenteur.rices de droits, mais aussi de faciliter et encourager une appropriation populaire de cette Déclaration par les paysans, les paysannes et les autres populations rurales dans leurs luttes politiques et juridiques aux niveaux local, national, régional et international. La formation avait également pour objectif central l’élaboration d’un plan stratégique pour influencer diverses instances gouvernementales, juridiques et politiques, visant la mise en œuvre de la Déclaration avec la participation active des paysans, des paysannes et des autres populations rurales dont les droits sont consacrés dans l’UNDROP.
Dans le cadre de cette première formation au Brésil, les participants des différents mouvements sociaux composant Via Campesina Brésil ont étudié l’histoire du processus de construction de l’UNDROP et le contenu de l’instrument, en soulignant les droits paysans à la terre, à la biodiversité, aux semences et à la souveraineté alimentaire. Dans un second temps, ils ont discuté de cas concrets de violations des droits établis par l’UNDROP survenus sur le territoire national, perpétrés surtout par des entreprises transnationales et des propriétaires terriens de l’agro-industrie.
Profitant du capital politique des mouvements sociaux présents, impulser la mise en œuvre de l’UNDROP depuis une perspective populaire est crucial dans le cadre du travail ardu et de longue haleine pour la justice sociale, la réforme agraire et la souveraineté alimentaire en milieu rural brésilien. Dans ce sens, le plan stratégique élaboré collectivement durant la formation a apporté une importante clarté sur le chemin à tracer pour promouvoir et mettre en œuvre l’UNDROP au Brésil et traduire ses dispositions tant dans le domaine légal que dans les politiques publiques.
Parmi les diverses initiatives à réaliser figure l’influence auprès des Nations Unies (ONU), en particulier auprès de son nouveau Groupe de Travail (GT) sur les droits des paysans et paysannes. En participant aux débats du GT et en collaborant à ses travaux, les organisations paysannes et rurales du monde entier peuvent utiliser ce mécanisme international pour faire avancer la mise en œuvre de l’UNDROP dans leurs pays respectifs. Après tout, l’une des fonctions du GT est précisément de recommander, soutenir et accompagner les pays membres de l’ONU dans la mise en œuvre de la Déclaration, afin qu’elle puisse être un vecteur direct dans l’élaboration de politiques publiques, de programmes et de lois réparant réellement les inégalités rurales.
En mars 2025, le GT a lancé un appel public pour que les organisations paysannes et rurales, ainsi que les gouvernements et autres institutions, collaborent à ses deux prochaines études portant sur les thèmes suivants : i. tendances globales des défis affectant les paysans et les paysannes; ii. droit des paysans et paysannes à une participation équitable. Ainsi, Via Campesina Brésil, à travers la Commission Pastorale de la Terre (CPT), le Mouvement des Petits Agriculteurs (MPA), le Mouvement des Affectés par les Barrages (MAB), le Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans Terre (MST), conjointement avec Terra de Direitos et avec le soutien technique du CETIM, a soumis un document afin de contribuer aux études du GT à partir des défis de la paysannerie brésilienne. Le document, disponible ici (en anglais), présente une perspective collective sur la conjoncture actuelle des défis paysans au Brésil, dont voici une synthèse :
Les paysans, les paysannes, les pêcheurs artisanaux, les peuples traditionnels et travailleurs ruraux au Brésil affrontent des défis structurels menaçant leurs modes de vie et droits fondamentaux. La concentration des terres et les conflits agraires sont aggravés par l’absence de réforme agraire et la privatisation des biens communs, entraînant violences et impunité. De plus, l’accès aux politiques publiques est limité par la bureaucratie, le manque d’assistance technique et d’infrastructures, tandis que la crise climatique et les grands projets, comme les barrages, déplacent des communautés et dégradent l’environnement. L’identité culturelle paysanne est aussi menacée par l’avancée de l’agro-industrie, qui remplace les pratiques durables par des monocultures et intensifie l’usage de pesticides. La criminalisation des luttes pour les droits territoriaux et le manque d’accès à la justice perpétuent également la vulnérabilité de ces populations, surtout indigènes, quilombolas et communautés extractivistes, qui subissent violences et exclusion sociale.
Le droit à la participation des paysans et paysannes et des travailleurs ruraux aux décisions politiques rencontre encore des obstacles majeurs au Brésil. L’exclusion de ces groupes se manifeste par le manque d’accès à l’information, la difficulté de représentation politique effective et l’absence de consultations préalables, libres et éclairées, notamment dans les processus de licenciement environnemental et de formulation de politiques publiques. Les communautés traditionnelles, comme les indigènes et quilombolas, voient souvent leurs droits violés, sans canaux adéquats pour influencer les décisions impactant leurs territoires et modes de vie. De plus, la marginalisation politique est aggravée par la prédominance de l’agro-industrie, qui concentre pouvoir et ressources, limitant la voix de l’agriculture familiale et des petits producteurs dans les espaces décisionnels nationaux et internationaux.
Malgré ces défis, il existe des mécanismes et politiques visant à élargir la participation rurale, comme les conseils de développement agricole (CONDRAF), les forums de discussion et les programmes de renforcement de l’agriculture familiale. La Déclaration de l’ONU sur les droits des paysans et des paysannes (UNDROP) et la Convention 169 de l’OIT offrent des bases légales pour exiger des consultations participatives. Cependant, l’efficacité de ces instruments dépend de la pression sociale, de l’accès à la justice et de l’engagement de l’État à garantir que les voix des campagnes soient entendues. Les mouvements sociaux jouent un rôle crucial dans cette lutte, organisant marches, occupations de terres et plaidoyer politique pour que les droits participatifs ne soient pas seulement formels, mais concrets et transformateurs.
À l’exemple de Via Campesina Brésil, la réalisation de processus de formation sur la déclaration aux niveaux national et/ou régional, l’élaboration d’un plan stratégique par les mouvements locaux pour sa promotion et la participation au Groupe de Travail de l’ONU sur l’UNDROP sont des étapes essentielles pour mettre en œuvre l’UNDROP aux niveaux national et international. C’est une voie fondamentale pour donner vie à la déclaration depuis la base, à travers l’appropriation de leurs droits par les détenteur·rice·s de droits et l’intégration de l’UNDROP dans leurs luttes politiques et juridiques pour la justice sociale et les droits humains des peuples ruraux.