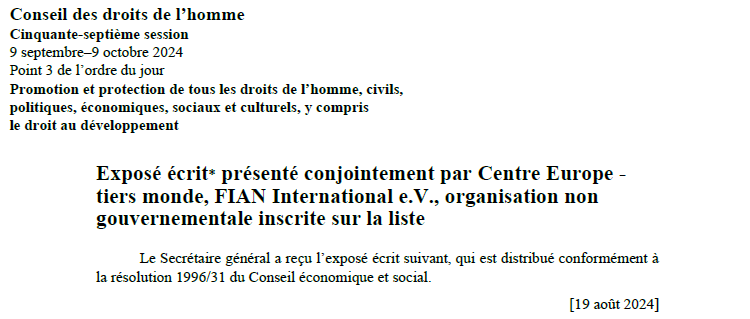Défis systémiques et bonnes pratiques dans les zones rurales – le 2e rapport du Groupe de travail de l’ONU sur l’UNDROP
Cet article a été publié initialement sur le site web de La Via Campesina le 25 septembre 2025 (disponible ici)
Sept ans après l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysan·ne·s et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP), le constat reste contrasté : certains progrès juridiques et politiques sont indéniables, mais les violations et les menaces systémiques persistent, voire s’intensifient. Lors de la 60e session du Conseil des droits de l’Homme, La Via Campesina, représentée par Alberto Silva pour l’organisation suisse Uniterre et au nom du CETIM, et FIAN représentée par Alfonzo Simon (Forum mondial des pêcheurs WFFP, organisation panaméenne SITRAMAR), ont souligné l’importance de placer les paysan·ne·s et les communautés rurales au cœur des politiques publiques et de protéger leurs droits territoriaux et fonciers face aux menaces croissantes.
Le deuxième rapport du Groupe de travail de l’ONU, présenté dresse un état des lieux saisissant : accaparement des terres et des océans, « green grabbing » au nom de la compensation carbone, violences et criminalisation des défenseurs, discriminations persistantes envers les femmes rurales. Pourtant, à côté de ces défis, le rapport met aussi en lumière des expériences positives, où des réformes foncières, des mécanismes judiciaires innovants et des initiatives agroécologiques démontrent qu’il est possible de placer les paysan·ne·s au cœur des politiques publiques. Entre menaces croissantes et bonnes pratiques inspirantes, ce rapport rappelle l’urgence d’une action collective pour faire de l’UNDROP une véritable feuille de route pour la dignité et la justice sociale, économique et climatique dans les zones rurales.
Synthèse du 2e rapport sur l’UNDROP : enjeux et recommandations
De l’accaparement des terres et des océans à la violence, criminalisation et répression des paysan.ne.s et pêcheur.se.s, en passant par les semences, les crises climatiques, les discriminations et à la sécurité sociale, le dernier rapport du Groupe de Travail dresse un panorama des défis systémiques auxquels les titulaires de droits prévus par l’UNDROP sont confronté·e·s.
Le rapport alerte notamment sur l’augmentation de «l’accaparement vert», c’est-à-dire l’appropriation de terres pour des motifs de compensation carbone. Sous couvert de protection durable de l’environnement des géants des énergies fossiles tels que Shell continuent d’investir massivement dans des projets de compensation, renforçant ainsi le contrôle des sociétés transnationales (STN) sur les terres et la financiarisation de la nature . Ces pratiques de «green grabbing» représentent aujourd’hui environ 20 % de toutes les acquisitions foncières à grande échelle, impactant les communautés rurales de plein fouet. Il en va de même pour l’accaparement des océans, le programme de l’économie bleue (avec des accords commerciaux et l’aménagement de l’espace marin) conduit à la marchandisation des océans et à l’appropriation des biens communs coutumiers par les STN.
«À l’échelle mondiale, 1 % des exploitations agricoles exploitent aujourd’hui 70 % des terres agricoles mondiales, tandis que 84 % des exploitations agricoles ne contrôlent que 12 % des terres agricoles. Les 10 % les plus riches de la population rurale accaparent 60 % de la valeur des terres agricoles, tandis que les 50 % les plus pauvres n’en accaparent que 3%.» cf Rapport A/HRC/60/33 du Groupe de Travail sur les droits des paysans, partie II.F. sur la concentration de la propriété foncière.
Dans un contexte de forte concurrence pour la terre et les ressources, les communautés rurales subissent violences, expulsions forcées, destructions et répression.
Les droits des paysannes notamment en matière de propriété foncière, de participation politique et d’accès aux ressources sont encore largement bafoués en raison de normes patriarcales, de cadres juridiques discriminatoires et d’oppressions croisées liées au sexe, à la ruralité, à la classe ou à l’ethnicité. Les paysannes subissent l’exclusion des prises de décisions, privation d’héritage et de contrôle agricole, surcharge de travail domestique non rémunéré, violences sexistes et accès restreint à l’éducation et aux soins. Cette discrimination structurelle accroît la pauvreté, l’insécurité alimentaire révélant l’urgence de réformes juridiques, sociales et économiques pour garantir leurs droits et la justice.
Malgré tout, le rapport recense aussi des bonnes pratiques constatées chez certains États, on citera : Au Mali, la nouvelle loi sur les terres agricoles, élaborée dans le cadre d’une plateforme multi-acteurs, est citée comme un bon exemple de participation adéquate et effective des paysan.ne.s aux processus politiques ; En Colombie, la création du tribunal agricole a pour objectif d’assurer la présence de juges et de procureurs dédiés exclusivement au règlement rapide et simplifié des conflits agraires. ; La loi foncière du Ghana comprend une protection novatrice qui annule toute décision ou pratique relevant du régime foncier coutumier qui entraîne une discrimination.
Le Groupe de travail recommande notamment de renforcer la reconnaissance juridique et la protection des organisations paysannes, syndicats, coopératives et mouvements de défense des droits fonciers, ainsi que des droits territoriaux de tou.te.s les titulaires de droits. Il appelle à abroger les lois antiterroristes et d’ordre public utilisées pour criminaliser les luttes paysannes, à mener des réformes agraires équitables, à supprimer les pratiques discriminatoires envers les femmes rurales et à réorienter les politiques agricoles. Les experts insistent sur la nécessité pour les États de reconnaître l’UNDROP, d’intégrer les droits paysans dans leurs cadres institutionnels et juridiques ainsi que dans les stratégies climatiques pour garantir que les financements soutiennent directement leurs solutions, plutôt que les intérêts commerciaux des STN.
Le dialogue interactif en réunion plénière du Conseil des droits de l’homme de l’ONU
Mercredi 17 septembre 2025, lors de la 60e session du Conseil des droits de l’Homme, le Président du Groupe de Travail sur les droits des paysan.ne.s, M. Carlos Duarte, a présenté le 2e rapport du Groupe en réunion plénière. S’il faut se réjouir du nombre grandissant de pays reconnaissant les droits des paysan.ne.s dans leur Constitution et législation, les menaces et violences envers les communautés rurales et autochtones augmentent aussi. Face à cela, Carlos Duarte rappelle que l’UNDROP est une feuille de route claire et qu’il est grand temps d’agir collectivement pour garantir une vie digne aux paysan.ne.s.
Lors du dialogue interactif, la majorité des États y a souligné que les paysan.ne.s sont essentiels à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire. La préoccupation quant à la concentration des terres dans les mains d’une poignée, les problèmes d’accès à la terre ont beaucoup été évoqués. Les États ont insisté sur la nécessité de politiques rurales durables, d’un meilleur accès aux terres, à l’eau, au crédit et aux marchés, et rappellent que les paysan.ne.s doivent participer directement aux décisions qui les concernent. Plusieurs pays (Bolivie, Gambie, Ghana, Tanzanie, Cameroun, Malawi, Honduras, Mexique, Soudan, Cuba, Venezuela) mettent en avant des défis récurrents : accaparement des terres, criminalisation des défenseur.e.s des droits humains, stigmatisation, discriminations fondées sur le genre, violences, effets du changement climatique et conflits armés. Ils insistent sur l’importance de politiques agricoles résilientes, de pratiques durables et de financements climatiques dirigés vers les solutions paysannes plutôt que commerciales. De nombreux États ont réaffirmé leur appui au Groupe de travail et leur volonté de coopération, ils appellent aussi à protéger les défenseur.e.s des droits paysans et à garantir des mécanismes de mise en œuvre plus solides de l’UNDROP.
De nombreux États ont présenté les actions entreprises pour promouvoir et mettre en œuvre les droits des paysan.ne. : En matière foncière, la Colombie a engagé une réforme rurale intégrale issue de l’accord de paix, tandis que la Côte d’Ivoire, le Malawi, le Togo, le Burkina Faso et l’Inde ont adopté des lois ou créé des agences pour régulariser et sécuriser l’accès à la terre. Plusieurs pays ont mis en avant des initiatives spécifiques en faveur des femmes rurales : programmes d’autonomisation en Azerbaïdjan, Mexique, Malaisie et Bangladesh. D’autres ont renforcé la protection sociale et les services de base dans les zones rurales, comme le Portugal, l’Espagne et l’Algérie, ou encore des programmes de soutien économique et technique aux petit.e.s exploitant.e.s (Gambie, Cameroun, Égypte, Iraq). Enfin, certains États ont insisté sur des mesures pour accroître la résilience face au changement climatique, à travers la promotion de pratiques agricoles durables, l’accès au crédit et aux intrants résistants (Bangladesh, Brésil, Indonésie, Iran).
Alberto Silva de La Via Campesina (représentant de l’organisation suisse Uniterre) parlant au nom du CETIM a souligné que le rapport du Groupe de Travail présente des expériences positives pouvant inspirer tous les États membres. Celles-ci démontrent que placer les paysan.ne.s au centre des politiques publiques, permet d’améliorer les conditions de vie et de travail dans les zones rurales. Alberto Silva a alerté sur les défis existentiels auxquels l’humanité fait face : accaparement des terres, érosion de la biodiversité, menace qui pèse sur les semences par la sélection industrielle et la dégradation de l’environnement… Face à ces menaces, l’UNDROP est un levier d’action juridique et politique efficace et concret, qui permet de renforcer les cadres législatifs nationaux et d’ouvrir des espaces de dialogues inclusifs. Il a appellé les États à collaborer avec les paysan.ne.s et le Groupe de Travail pour faire avancer les droits des paysans contenus dans l’UNDROP.
Alfonzo Simon du Forum mondial des pêcheurs WFFP (représentant de l’organisation panaméenne SITRAMAR), parlant au nom de FIAN, a remercié le Groupe de Travail pour son rapport qui reconnaît l’érosion des droits territoriaux (terre, fleuves, eaux…). Les pêcheurs, peuples autochtones et communautés rurales du Panama font face à une forte répression quand iels défendent leurs droits ou résistent aux déplacements forcés. Alors qu’iels sont les gardien.ne.s de la biodiversité et des systèmes alimentaires, leurs modes de vie sont de plus en plus menacés par l’industrie agroalimentaire et extractive, les agendas de conservation comme l’initiative 30×30.
«Nous, les pêcheur·euse·s autochtones, ne sommes pas des menaces pour la biodiversité, nous en sommes les gardien·ne·s. Nos voix doivent être entendues et nos droits protégés.»
Alfonzo est venu du Panama dénoncer la situation urgente des pêcheur.se.s indigènes Ngäbe Buglé menacé.e.s par le gouvernement de suspension de la pêche sur l’île Escudo de Veragua, leur dernier lieu de pêche ancestral. Il demande au Groupe de Travail d’inciter l’État de Panama à mettre fin à ces dispositions, à la violence ainsi que de reconnaître leurs droits (consacrés par l’ UNDRIP et l’UNDROP) et de garantir leur participation aux décisions qui impactent leur mode de vie.